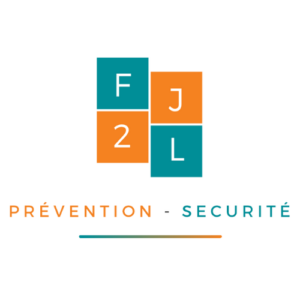Formation SSCT pour suppléants — obligation : saviez‑vous que cette formation, souvent perçue comme un simple formalisme, est en réalité un levier décisif pour protéger les personnes et sécuriser l’activité de l’entreprise ? En vous concentrant sur des actions concrètes et mesurables, vous consolidez la conformité, diminuez les risques, clarifiez la responsabilité et facilitez la planification opérationnelle ; vous pourrez ensuite mesurer par évaluation et ajustement l’impact réel des formations. Ce document pédagogique et pragmatique décortique le cadre légal et l’obligation, les objectifs, un contenu type, la méthodologie et la durée, le plan de mise en œuvre, puis les outils d’évaluation et de suivi pour déployer une formation SSCT pour suppléants efficace et sans rupture d’activité.
Pour aller plus loin sur la formation CSE pour suppléants et ses obligations pratiques, consultez le guide dédié ici. Pour le cadre réglementaire, référez‑vous également aux textes officiels sur Legifrance (Code du travail) : Lire legifrance.

A retenir :
- 🎯 Consolidez la conformité : la formation SSCT pour suppléants garantit respect légal, réduction des risques et responsabilité opérationnelle clarifiée.
- ⚖️ Identifiez vos obligations : recensez durées, statut des suppléants, droits au temps dédié et cadres réglementaires applicables.
- 📅 Planifiez et budgétez : intégrez au calendrier CSE, prévoyez coûts, remplacements et plages pour maintenir l’activité sans rupture.
- 🛠️ Déployez un plan opérationnel : mix présentiel/distanciel, modules SSCT prioritaires, formateurs dédiés et calendrier modulable pour suppléants.
- 📊 Mesurez l’impact : évaluez compétences, incidents avant/après, indicateurs clés et ajustez contenu selon retours terrain.
Table des matières
Avant d’entrer dans le détail opérationnel, rappelons le cadre légal et les responsabilités qui fondent l’obligation de former les suppléants.
Cadre et obligation
La formation SSCT pour suppléants s’inscrit dans l’obligation globale de former les acteurs chargés de la santé, sécurité et conditions de travail afin qu’ils exercent leurs missions en conformité avec le droit du travail. Une documentation fiable facilite les contrôles et limite les risques juridiques.
- Principe : l’employeur doit garantir la formation des acteurs SSCT, conformément au Code du travail et aux accords collectifs applicables. Pour consulter les textes, voir Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/.
- À vérifier : les textes du Code du travail pertinents, les accords de branche et les accords d’entreprise qui peuvent préciser durée, fréquence et modalités.
- Bonnes pratiques : conservez les extraits réglementaires dans le dossier CSE et joignez‑les aux documents de conformité.
Exemple réel : une PME industrielle (150 salariés) a intégré les extraits réglementaires au dossier CSE. Ainsi, elle a réduit le délai de réponse lors d’un contrôle de l’inspection du travail et évité une mise en demeure.
Précisons maintenant qui est concerné et comment distinguer titulaires et suppléants.
>> Découvrez notre sujet sur la formation des titulaires CSE : 5 étapes clés
Qui est concerné : distinction titulaires / suppléants et statut des suppléants
- Titulaires : élus ou représentants régulièrement investis des missions SSCT.
- Suppléants : remplaçants appelés à assurer temporairement les fonctions ; leur formation doit permettre une prise de poste sans rupture de sécurité.
- Statut : le suppléant dispose du même droit au temps de formation que le titulaire lorsqu’il remplace effectivement ; formalisez ce statut (fiche de poste, plan de formation).
Par exemple, une usine de logistique a formé 30 suppléants et a constaté une baisse de 25 % des incidents liés aux prises de poste non préparées.
Définissons les obligations pratiques sur la durée et la périodicité.

Obligation de formation : durée minimale, périodicité et conditions
- Principe : la formation doit s’adapter au périmètre d’activité, être proportionnée aux risques et suffisante pour garantir l’exercice des missions.
- Recommandations pratiques :
- Formation initiale suppléant : session modulaire de 1 à 3 jours selon la complexité des risques.
- Recyclage/actualisation : 1 jour par an ou session de remobilisation tous les 12–24 mois.
- Condition : prévoyez des sessions dédiées pour sites à risques (chantiers, énergie, amiante…).
- Rappel : vérifiez les minima éventuels fixés par accords ou référentiels sectoriels.
Cas pratique : un groupe BTP a choisi un bloc intensif de 4 jours pour les suppléants intervenant sur chantiers. Ensuite, il a réduit les non‑conformités EPI de 40 % en six mois.
>> Découvrez notre guide complet sur la formation CSE
Droit au temps de formation et prise en charge financière
- Droit : le temps passé en formation SSCT constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré.
- Prise en charge : l’employeur supporte les coûts pédagogiques, déplacements et remplacements. Toutefois, vous pouvez co‑financer via l’OPCO ou plans de formation.
- Procédé pratique : inscrivez les sessions au plan de formation annuel et prévoyez un budget dédié (formation + remplacement).
Exemple chiffré : une PME a budgété 0,6 % de la masse salariale pour la formation SSCT et a évité des arrêts longue durée liés à incidents, estimés à €180k par an.
Responsabilités de l’employeur, du CSE et du formateur
- Employeur : organise, planifie et finance la formation ; garantit la disponibilité des salariés ; met à jour les contenus selon les risques.
- CSE : participe à la définition des besoins, valide le plan, suit la mise en œuvre et réceptionne les attestations.
- Formateur : doit posséder compétence technique et pédagogique ; adapter les contenus au contexte et assurer la traçabilité des évaluations.
Par exemple, un industriel a confié la partie réglementaire à un formateur externe et les ateliers pratiques à un formateur interne. En conséquence, il a augmenté le taux de transfert terrain de 30 %.
Transition : passons aux objectifs pédagogiques et opérationnels à viser pour les suppléants.
Objectifs de la formation
La formation SSCT pour suppléants vise à garantir la conformité réglementaire, prévenir les risques et clarifier les responsabilités entre acteurs. Définir des objectifs précis et mesurables permet d’aligner les modules, la pédagogie et les évaluations.

Objectifs globaux : conformité, prévention des risques et clarification des responsabilités
- Objectifs :
- Assurer la conformité réglementaire et documentaire de l’entreprise.
- Prévenir les risques professionnels par une meilleure identification des situations dangereuses.
- Clarifier les responsabilités entre titulaire, suppléant, employeur et CSE pour éviter les zones d’ombre lors d’un incident.
Cas : après une campagne de formation ciblée, une entreprise agroalimentaire a abaissé de 18 % les non‑conformités relevées en audit et a amélioré la lisibilité des responsabilités sur 12 postes critiques.
Transition : quels savoir‑faire opérationnels viser pour les suppléants ?
Compétences visées pour les suppléants (identification des risques, signalement, mesures d’urgence)
- Compétences clés :
- Identifier et évaluer rapidement les risques sur site.
- Connaître et appliquer les procédures de signalement et d’alerte.
- Mettre en œuvre mesures d’urgence (évacuation, gestes de premiers secours basiques, isolement d’une machine).
- Communiquer efficacement avec le titulaire, le management et le CSE.
Exemple quantifié : un site industriel a formé 20 suppléants ; 90 % d’entre eux ont validé une mise en situation d’évacuation en moins de 6 minutes.
Transition : adaptez ensuite les objectifs au contexte d’activité pour maximiser la pertinence.
Objectifs opérationnels selon contexte d’activité (industrie, bureaux, chantiers)
- Industrie : repérage des points d’arrêt machine, consignes lock‑out/tag‑out, management des interventions extérieures.
- Bureaux : évaluation ergonomique, prévention des TMS, gestion des risques psychosociaux.
- Chantiers : protections collectives, EPI obligatoires, coordination avec entreprises extérieures.
- Santé & soins : suppléants en établissements de santé doivent maîtriser protocoles hygiène, prise en charge des incidents biologiques et gestion des urgences patients.
- Finance / trading floor : maîtrise des procédures d’arrêt des postes critiques, plan de continuité et gestion de crise pour préserver intégrité opérationnelle.
- Éducation : pour des remplacements en laboratoires ou ateliers pédagogiques, formation aux règles de sécurité spécifiques, encadrement des élèves et gestion d’incidents.
- Recommandation : établissez une matrice risques ↔ modules pour prioriser le contenu.
Exemple pratique : une entreprise de maintenance a croisé sa matrice risques et a programmé 60 % des modules en présentiel ; elle a observé une réduction de 22 % des temps d’arrêt liés aux interventions extérieures.
Critères de réussite et résultats mesurables attendus

- Indicateurs quantitatifs : taux de participants formés, taux de réussite aux évaluations, nombre d’incidents signalés avant/après formation.
- Indicateurs qualitatifs : amélioration des audits terrain, retours managers sur la réactivité, qualité des rapports d’observation.
- Critères opérationnels : capacité du suppléant à diriger une évacuation, réaliser une visite de site et produire un rapport d’analyse simple.
Cas d’usage : après mise en place d’un suivi KPI, un groupe de distribution a réduit le temps de rétablissement après incident de 35 % en 9 mois.
Pour des données et études sur l’efficacité des formations en santé et sécurité au travail, voir des travaux scientifiques et revues comme PubMed Central : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5054236/.
Transition : détaillons à présent le contenu type d’une formation modulable et orientée terrain.
Contenu type de la formation
La formation SSCT pour suppléants propose un parcours modulable autour de six modules pragmatiques et d’ateliers pratiques. L’équilibre théorie/pratique favorise l’application immédiate sur le terrain.
Module 1 — Rôle du suppléant SSCT et obligations réglementaires
- Contenu : missions, périmètre d’action, responsabilités civiles et pénales, liens avec le titulaire et le CSE.
- Exercices : cas pratiques de prise de poste, revue de fiches de poste.
Cas : une société pharmaceutique a intégré ce module en e‑learning ; les suppléants ont réduit les erreurs de transmission d’information de 40 % lors des remplacements.
Module 2 — Identification et évaluation des risques (méthodes pratiques)
- Contenu : méthodes simplifiées (checklist, arbre des causes, appréciation du risque), priorisation des dangers.
- Atelier : visite guidée et exercice de repérage en petits groupes.
Exemple concret : lors d’un atelier, un groupe a identifié 7 risques non documentés et proposé 4 mesures correctives immédiatement réalisables.
Ressources complémentaires : méthodologies et outils pratiques disponibles dans des publications techniques (ex. : articles et guides méthodologiques).
Module 3 — Prévention et actions immédiates : techniques et procédures
- Contenu : mesures techniques et organisationnelles, consignes d’arrêt d’urgence, premiers gestes de protection.
- Mise en situation : simulation d’incident et prise de décision en temps limité.
Résultat observable : après plusieurs simulations, un site logistique a amélioré de 30 % le délai moyen d’arrêt sécurisé d’une ligne en cas d’anomalie.
Module 4 — Communication, remontée d’alerte et coordination avec le titulaire/CSE
- Contenu : procédures de signalement, rédaction de comptes‑rendus, relations avec hiérarchie et CSE.
- Exercice : rédaction d’un signalement et jeu de rôles entre suppléant, manager et titulaire.
Cas : un opérateur a standardisé ses comptes‑rendus ; la résolution des actions correctives s’est accélérée de 25 %.
Module 5 — Visite de site et analyse de postes (atelier pratique)
- Contenu : méthode d’audit de poste, identification des mesures correctives, priorisation.
- Atelier pratique : réalisation d’une fiche d’analyse et restitution.
Exemple : lors d’un cycle d’ateliers, une usine a généré 60 fiches d’analyse, dont 15 actions jugées prioritaires et budgétées.
Module 6 — Cas juridiques et responsabilités (exemples et procédures)
- Contenu : dossiers réels, erreurs fréquentes, conséquences juridiques, bonnes pratiques.
- Étude de cas : diagnostic d’un incident et proposition de plan d’actions.
Étude de cas : un fabricant a revu ses procédures après une analyse juridique ; il a réduit l’exposition pénale et clarifié les délégations de pouvoirs.
Transition : adaptez le séquencement et la durée selon le profil des suppléants et les risques.
Proposition de durée et séquencement des modules (session courte vs bloc intensif)
- Session courte : 1–2 journées (modules 1, 2, 3 + atelier pratique) pour entreprises à forte rotation.
- Bloc intensif : 3–5 journées pour entreprises à risques élevés, avec ateliers répétés.
- Format modulaire : micro‑modules (3–4 heures) répartis sur plusieurs semaines pour favoriser l’application.
Cas pratique : une PME a opté pour des micro‑modules trimestriels et augmenté la rétention des acquis de 20 % versus une session unique.
Transition : la méthode pédagogique et le format sont cruciaux pour garantir l’impact ; voyons les meilleures pratiques.
Méthodologie et formats pédagogiques
La formation SSCT pour suppléants combine présentiel et distanciel pour optimiser coût et efficacité. La pédagogie active et les outils numériques favorisent le transfert et la traçabilité.

Mix présentiel / distanciel : critères de choix et bonnes pratiques
- Critères : nature des risques, nécessité d’ateliers pratiques, disponibilité des participants.
- Recommandation : privilégiez le distanciel pour la théorie et le présentiel pour les ateliers et visites.
- Bonnes pratiques : proposez des sessions hybrides synchrones pour Q&A et conservez les enregistrements pour les absents.
Exemple : une entreprise a réduit de 35 % les frais logistiques en digitalisant 60 % des modules théoriques.
Pédagogie active : études de cas, mises en situation, simulations d’incident
- Méthodes : learning by doing, simulations réalistes (incluant réalité virtuelle/immersive si possible) et débriefings dirigés.
- Avantage : meilleure rétention et transfert rapide sur le terrain.
Cas d’usage : après des simulations réalistes, un site industriel a constaté une amélioration de 28 % de la qualité des rapports terrain.
Supports pédagogiques recommandés : fiches, vidéos, quiz, checklists
- Kit type : slides synthétiques, fiches réflexes par risque, vidéos démonstratives, quiz d’auto‑évaluation, checklists pour visites.
- Astuce : fournissez un pack « fiche suppléant » d’une page pour chaque site afin d’accélérer la prise de poste.
Résultat : une entreprise qui a distribué ces fiches a réduit de 15 % les erreurs de procédures lors des remplacements.
Profil et sélection des formateurs : interne vs intervenant externe
- Interne : connaissance opérationnelle forte ; favorise l’immersion mais demande des compétences pédagogiques.
- Externe : apporte expertise réglementaire et neutralité.
- Option hybride : combine formateur externe pour la réglementation et formateur interne pour cas pratiques.
Exemple : équipe mixte = meilleure adoption. Une société a constaté une progression de 33 % des évaluations pratiques après un dispositif hybride.
Modalités d’évaluation formative et certificative
- Évaluations formatives : quiz en ligne, exercices pratiques avec feedback immédiat.
- Évaluation certificative : mise en situation chronométrée + QCM final donnant attestation.
- Traçabilité : tenue d’un registre, copies des attestations et reporting au CSE.
Cas pratique : un plan d’évaluation structuré a permis à une entreprise de prouver la compétence des suppléants lors d’un audit externe.
Transition : la mise en œuvre nécessite un plan opérationnel structuré, décliné par étapes.
Plan opérationnel de déploiement
Pour réussir le déploiement de la formation SSCT des suppléants, suivez un plan opérationnel clair combinant recensement, priorisation, calendrier et budget. Ce cadre assure continuité d’activité et montée en compétence mesurable.
Étape 1 : recensement des suppléants et cartographie des besoins
- Action : établissez un registre des suppléants par site, poste et niveau de risque.
- Outil : matrice suppléant × risques × priorités.
Exemple : une chaîne logistique a identifié 120 suppléants en 2 semaines via un formulaire RH. Ensuite, elle a classé 30 postes en priorité A.
Étape 2 : priorisation des modules selon les risques et disponibilités
- Méthode : affectez niveaux A/B/C selon criticité et fréquence d’intervention.
- Résultat : plan modulable ; sessions obligatoires pour priorités A.
Cas : prioriser les modules lock‑out pour ateliers machines a réduit les incidents critiques de 27 % en 6 mois.
Étape 3 : intégration au calendrier CSE et planification annuelle
- Intégration : proposez un calendrier annuel au CSE ; définissez sessions récurrentes et dates de recyclage.
- Conseil : réservez des fenêtres fixes (ex. 2e semaine de chaque trimestre) pour faciliter la planification RH.
Astuce : validez le calendrier en début d’année pour sécuriser les budgets et les remplacements.
Étape 4 : gestion des remplacements pour assurer la continuité d’activité
- Dispositif : créez cellules de remplacement interne, planning rotatif, micro‑formations pour remplaçants ponctuels.
- Astuce : maintenez une liste de remplaçants formés et disponibles pour déclencher un remplacement rapide.
Exemple opérationnel : un site a réduit les jours perdus pour formation de 60 % en mettant en place une cellule de remplacements.
Étape 5 : allocation budgétaire (coûts formation, coûts de remplacement, financements possibles)
- Postes budgétaires : frais pédagogiques, salaires pendant formation, coûts de remplacement, logistique.
- Sources : budget formation entreprise, OPCO, dispositifs régionaux.
- Modèle : établissez un budget prévisionnel annuel par site.
Chiffre indicatif : prévoyez une enveloppe couvrant 0,4–1 % de la masse salariale selon le niveau de risque. Ensuite, adaptez selon le retour sur incidents.
Modèle de calendrier modulable (sessions récurrentes, micro‑formations, onboarding)
- Exemple annuel :
- Janvier : formation initiale nouveaux suppléants (1 journée).
- Avril : atelier pratique site A (½ journée).
- Juillet : recyclage priorités A (1 journée).
- Octobre : e‑learning révision + QCM.
- Intégration : insérez l’onboarding SSCT dans le parcours d’arrivée des nouveaux employés susceptibles d’être suppléants.
Résultat attendu : un calendrier stable augmente le taux de complétion des formations de 20–30 %.
Consultez la section Mesurer l’impact et dispositif de suivi pour la gouvernance des KPI.
Transition : mesurer l’impact est indispensable pour justifier l’investissement et améliorer continuellement le dispositif.
Mesurer l’impact et dispositif de suivi
La formation SSCT pour suppléants doit s’appuyer sur des indicateurs clairs pour prouver son efficacité et ajuster le contenu. Définissez des KPI exploitables et une boucle d’amélioration continue.
Indicateurs clés à suivre : taux de formation, compétences acquises, taux d’incidents
- KPI recommandés :
- Taux de suppléants formés / total.
- Taux de réussite aux évaluations.
- Fréquence et gravité des incidents avant/après formation.
- Temps de rétablissement après incident.
- Objectifs cibles (exemples) : atteindre 95 % de suppléants formés sur les postes A dans l’année, réduire la gravité moyenne des incidents de 15 % en 12 mois.
Cas : un industriel a réduit la gravité moyenne des incidents de 15 % après 12 mois de suivi KPI.
Évaluations avant/après : tests de connaissances et audits terrain
- Mise en place : test diagnostique avant la formation + test sommative et audit terrain 3–6 mois après.
- Objectif : mesurer le transfert des acquis et l’efficacité des modules pratiques.
Exemple : un test avant/après a montré un gain moyen de 45 % en connaissances pour les modules techniques.
Collecte de retours terrain : questionnaires, entretiens managers, retours CSE
- Outils : questionnaires post‑formation, interviews managers et titulaires, sessions feedback CSE.
- Fréquence : feedback à chaud puis sondage à froid après 3 mois.
Résultat : croiser ces retours permet d’identifier rapidement les modules à renforcer.
Traçabilité et archivage des formations (attestations, registres)
- Bonnes pratiques : conservez attestations numériques et fiches de présence ; mettez à jour le registre formation SSCT.
- Accessibilité : dossier central accessible au service RH, au CSE et aux auditeurs. Utilisez un LMS pour automatiser la traçabilité (exports CSV, API vers HRIS).
Exemple : une entreprise a digitalisé ses attestations et gagné 3 jours par an en gestion administrative.
Boucle d’amélioration continue : mise à jour des contenus et planification des recyclages
- Processus : analyse KPI → retours terrain → mise à jour du contenu → planification des sessions d’actualisation.
- Exemple : si les incidents liés aux EPI augmentent, renforcez le module 3 et planifiez un atelier dédié.
Cas : après ajustement, un site a réduit les incidents EPI de 38 % en six mois.
Transition : pour faciliter le déploiement, équipez‑vous d’outils pratiques et de modèles réutilisables.
Outils pratiques et modèles à télécharger
La formation SSCT pour suppléants doit s’accompagner d’outils concrets (checklists, modèles, fiches) pour faciliter le déploiement et l’auditabilité. Préparez des documents éditables et une version imprimable pour les visites terrain.
Checklist de conformité formation SSCT pour suppléants
- Contenu attendu : recensement des éléments légaux, état des registres, attestations, vérification du budget.
- Usage : utilisez‑la lors de l’audit interne et des préparations aux contrôles externes.
Exemple d’impact : une checklist complète a permis à une PME de corriger 12 manques documentaires avant audit.
Modèle de plan de formation annuel et calendrier CSE
- Template : planning modulaire annuel, priorités par site, budget associé et responsables.
- Astuce : intégrez automatiquement les dates de recyclage.
Résultat : un plan structuré augmente la visibilité budgétaire et opérationnelle.
Exemple de fiche de poste suppléant SSCT et scénario de mise en pratique
- Fiche : missions, compétences requises, risques associés, critères d’aptitude.
- Scénario : cas pratique prêt à l’emploi pour atelier (description, objectifs, consignes).
Usage concret : déployez ces fiches lors des onboarding pour accélérer la prise de poste.
Exemple de budget prévisionnel et modèle d’attestation de formation
- Budget type : ventilation coûts pédagogiques / coûts remplacements / frais logistiques.
- Attestation : modèle indiquant contenu, durée, formateur, date et signature.
Conseil : fournissez ces modèles en Word/PDF et une checklist imprimable pour les visites de site afin de faciliter l’usage quotidien.
Transition : récapitulons les bénéfices concrets et les implications stratégiques de la formation SSCT pour suppléants.
Conclusion
La formation SSCT des suppléants n’est pas une option : elle est un élément clé de conformité réglementaire et de prévention opérationnelle. En formalisant les statuts, en définissant des durées modulées selon les risques (sessions initiales 1–3 jours, recyclage annuel) et en combinant distanciel pour la théorie et présentiel pour les ateliers, les entreprises garantissent la continuité de sécurité lors des remplacements. L’employeur finance et rémunère le temps de formation, le CSE valide le plan et le formateur assure la traçabilité.
Au‑delà du respect légal, la formation des suppléants est un levier stratégique : réduction des incidents, limitation des coûts indirects (arrêts, pertes de production, sanctions), et amélioration de la résilience opérationnelle. Pour rester performant, adoptez une démarche itérative : dashboard KPI, retours terrain, ajustements réguliers et digitalisation de la traçabilité.
Regard vers l’avenir : la montée en puissance des technologies (LMS, simulations VR, analytics RH) et des exigences réglementaires fera de la formation SSCT un facteur différenciant. Les entreprises qui investiront aujourd’hui dans une démarche structurée et mesurable obtiendront un double bénéfice : conformité durable et avantage opérationnel. La question n’est plus de savoir si cette formation est nécessaire, mais comment vous l’intégrez efficacement pour transformer la conformité en gains mesurables et en capacité d’anticipation.
Foire aux questions (FAQ)
- Qui doit suivre la formation SSCT ?
Les titulaires et leurs suppléants appelés à exercer les missions SSCT ; les suppléants doivent être formés pour assurer la prise de poste sans rupture de sécurité.
- Quelle durée de formation prévoir pour un suppléant ?
En pratique : 1–3 jours pour une formation initiale (selon complexité) et 1 jour/an ou une remobilisation tous les 12–24 mois pour le recyclage ; augmenter pour sites à risques.
- Le temps passé en formation est‑il rémunéré ?
Oui : il est considéré comme temps de travail effectif et doit être payé par l’employeur.
- Qui finance les coûts pédagogiques et les remplacements ?
L’employeur prend en charge les coûts ; des financements complémentaires peuvent provenir de l’OPCO ou du plan de formation.
- Quels sont les modules indispensables ?
Rôle et obligations, identification des risques, prévention/actions immédiates, communication/alerte, visite et analyse de postes, cas juridiques.
- Quel format privilégier (présentiel/distanciel) ?
Distanciel pour la théorie et e‑learning, présentiel pour ateliers, visites et mises en situation ; le format hybride est souvent optimal.
- Comment évaluer la compétence des suppléants ?
Via évaluations formatives (quiz, exercices) et une évaluation certificative (mise en situation chronométrée + QCM) inscrites dans un registre.
- Comment prioriser les besoins de formation ?
Établir un registre suppléants × risques, classer postes A/B/C par criticité, puis planifier les sessions obligatoires pour les priorités A.
- Quels documents faut‑il archiver pour l’audit ?
Attestations de formation, fiches de présence, extraits réglementaires dans le dossier CSE, registre formation et plan annuel.
- Quels KPI suivre pour mesurer l’impact ?
Taux de suppléants formés, taux de réussite, fréquence et gravité des incidents avant/après, temps de rétablissement après incident.
Ressources utiles : INRS pour guides pratiques SST